Dialogue avec le Juif Tryphon - Extrait
Extrait du livre "Dialogue avec le Juif Tryphon", de saint Justin. Une discussion philosophique sur le sens de la vie retraçant une discussion entre saint Justin, catholique, et Tryphon, juif pratiquant.
Dialogue avec le Juif Tryphon. Chapitre I
Je me promenais un matin dans les galeries du Xiste, lorsqu’un homme vint à moi avec les personnes qui l’accompagnaient et me dit en m’abordant : « Salut, philosophe ! » et après ces mots, il se mit à marcher à mes côtés. Ses amis en firent autant. Je le saluai à mon tour, et lui demandai ce qu’il me voulait.
— Lorsque j’étais à Argos, me dit-il, j’appris d’un corinthien, disciple de Socrate, qu’il ne fallait pas dédaigner ou mépriser ceux qui portent votre habit, mais leur témoigner toute sorte d’égards, se lier avec eux et par l’échange des idées s’éclairer mutuellement ; on s’en trouve bien de part et d’autre, quand les services sont ainsi réciproques ; aussi toutes les fois que je rencontre un homme avec l’habit de philosophe, je me plais à l’aborder : voilà pourquoi je me suis empressé de vous adresser la parole. Les personnes qui se trouvaient avec moi m’ont suivi, dans l’espoir de profiter aussi de votre entretien.
— Et qui êtes-vous donc, ô le plus grand des mortels ? lui dis-je en riant.
Il me fit connaître, sans détour, son nom et son origine. Je m’appelle Tryphon, me dit-il, je suis Hébreu et circoncis ; chassé de ma patrie par la dernière guerre, je me suis retiré dans la Grèce et je demeure ordinairement à Corinthe.
— Et qu’espérez-vous de la philosophie ? lui demandai-je ; peut-elle vous être aussi utile que votre législateur et vos prophètes ?
— Est-ce que les philosophes, reprit Tryphon, ne s’occupent pas uniquement de Dieu ; leurs discussions n’ont-elles pas toutes pour objet son unité, sa providence ? Enfin, si je ne me trompe, la philosophie n’a pas d’autre but que la connaissance de Dieu.
— Oui, ce devrait être l’objet de toutes ses recherches ; mais qu’il existe plusieurs dieux, ou qu’il n’en existe qu’un seul ; qu’il veille ou non sur chacun de nous, voilà ce que bien peu de philosophes cherchent à savoir, comme si cette connaissance importait peu au bonheur ! Ils s’efforcent seulement de nous persuader que si Dieu prend soin de l’univers, des genres, des espèces ; il ne s’occupe ni de vous, ni de moi, ni d’aucun être en particulier. Ils vous diront même qu’il est fort inutile de le prier jour et nuit. Vous voyez où tendent leurs doctrines ; ils ne cherchent qu’à s’assurer la licence et l’impunité, d’agiter et de suivre les opinions qui leur plaisent, de faire et dire ce qu’ils veulent, n’attendant de la part de Dieu ni châtiment, ni récompense. En effet, que peuvent craindre ou espérer des hommes qui enseignent que rien ne doit changer, que nous serons toujours vous et moi ce que nous sommes aujourd’hui, ni meilleurs ni pires ? D’autres, partant de l’idée que l’âme est spirituelle et immortelle de sa nature, pensent qu’ils n’ont rien à craindre après cette vie, s’ils ont fait le mal ; parce que d’après leurs principes un être immatériel est impassible, et qu’on peut se passer de Dieu puisque l’on ne peut mourir.
Alors Tryphon me dit avec un sourire gracieux : Et vous, que pensez-vous sur toutes ces questions ? Quelle idée avez-vous de Dieu ? Quelle est votre philosophie, dites-le nous ?
Dialogue avec le Juif Tryphon. Chapitre II.
— Je vous dirai tout ce que je pense, lui répondis-je. Assurément la philosophie est le plus grand de tous les biens et le plus précieux devant Dieu, puisqu’elle nous conduit à lui et nous rend agréables à ses yeux ; aussi je regarde comme les plus grands des mortels ceux qui se livrent à cette étude. Mais qu’est-ce que la philosophie ? Descendue du ciel pour éclairer les hommes, d’où vient qu’elle reste cachée à la plupart ? Il ne devrait y avoir ni platoniciens, ni stoïciens, ni péripatéticiens, ni pythagoriciens, ni contemplatifs ; mais il importe, puisque cette science est une, de dire pourquoi nous la voyons ainsi divisée. Ceux qui s’occupèrent les premiers de philosophie se firent un nom célèbre par cette étude ; ils eurent des successeurs qui adoptèrent leur doctrine sans chercher par eux-mêmes la vérité ; frappés de la vertu, de la force d’âme, du langage sublime de leurs maîtres, ils les crurent sur parole, tinrent pour vrai ce qu’ils en avaient reçu, et transmirent à leurs propres disciples ces premières opinions avec celles qui s’en rapprochaient le plus, en conservant le nom donné primitivement au père ou chef de l’école. Je voulus autrefois connaître ces divers systèmes de philosophie. Je m’attachai d’abord à un stoïcien ; mais voyant qu’un long séjour chez lui ne m’avaient rien appris de plus sur Dieu que je n’en savais (faut-il s’en étonner ? il ne le connaissait pas lui-même et ne pensait pas que cette connaissance fût nécessaire), je le quittai pour m’adresser à un péripatéticien, homme très-habile, du moins c’est ce qu’il croyait. Après m’avoir souffert près de lui les premiers jours, il me pria de fixer ce que je voulais lui donner pour ces leçons, afin, disait-il, qu’elles fussent utiles à tous deux. Là-dessus je le quittai, jugeant qu’il n’était rien moins que philosophe. Mais comme je voulais avant tout savoir ce qui fait le fond et l’essence de la philosophie, j’allai trouver un pythagoricien qui était en grande réputation, et il avait lui-même une haute idée de sa sagesse ; je lui exprimai le désir d’être admis au nombre de ses auditeurs et de jouir de son intimité. « Volontiers, me dit-il ; mais savez-vous la musique, l’astronomie, la géométrie ? penseriez-vous comprendre la science qui mène au bonheur sans posséder ces connaissances premières qui dégagent l’âme des objets sensibles, la rendent propre à saisir les choses intellectuelles, à contempler le beau, le vrai dans son essence. » Il me fit le plus grand éloge de ces diverses connaissances et me dit qu’elles étaient indispensables ; mais je lui répondis que je les ignorais complètement, et là-dessus il me congédia. Je fus, comme vous le pensez, fort affligé de me voir ainsi trompé dans mes espérances, d’autant plus que je lui croyais quelque savoir ; mais songeant à tout le temps que me demanderaient ces études, je ne pus supporter l’idée de me voir rejeté si loin de mon but. Je ne savais plus à quoi me résoudre, lorsque je pensai aux platoniciens ; ils étaient en grande vogue. Un des plus célèbres venait d’arriver à Naplouse, c’est avec lui que je me liai principalement ; je gagnais beaucoup à ses conversations, mon esprit grandissait tous les jours. Ce que je pus comprendre des choses immatérielles me transportait, et la contemplation des idées donnait comme des ailes à ma pensée : je croyais être devenu sage en peu de temps, et telle était ma folie, que je conçus l’orgueilleux espoir de voir bientôt Dieu lui-même, car c’est là le but que se propose la philosophie de Platon.
Dialogue avec le Juif Tryphon. Chapitre III.
Cette disposition d’esprit me faisait chercher les plus profondes solitudes et fuir toute trace d’hommes, je me retirai donc dans une campagne à peu de distance de la mer ; comme j’approchais de l’endroit que j’avais choisi pour être seul avec moi-même, je m’aperçus qu’un vieillard d’un aspect vénérable, et d’une physionomie pleine de douceur et de gravité, me suivait d’assez près ; je m’arrêtai en me tournant vers lui et je le regardai avec beaucoup d’attention : — Vous me connaissez donc, me dit-il ?
— Non, lui répondis-je.
— Pourquoi donc me regarder ainsi ?
— Je m’étonne, lui répondis-je, de vous voir avec moi dans ce lieu, je m’y croyais seul.
— Je suis inquiet, me répondit le vieillard, de quelques-uns de mes amis ; ils sont partis pour un long voyage : je n’en ai pas de nouvelles. Je suis venu sur les bords de la mer pour tâcher de les découvrir de quelques côtés. Mais vous, quel motif vous amène en ces lieux ?
— J’aime, répondis-je, les promenades solitaires où rien ne distrait l’esprit, où l’on peut librement causer avec soi-même. Ces lieux sont bien propres aux graves études.
— Je le vois, vous êtes philologue, c’est-à-dire ami des mots, et non des œuvres et de la vérité. Vous aimez mieux être un raisonneur qu’un homme d’action.
— Eh ! lui dis-je, quoi de plus grand et de plus utile que de montrer aux hommes que c’est la raison qui doit commander en nous ; que d’étudier, en la prenant soi-même pour guide et pour appui, les passions et les erreurs qui travaillent les autres ; que de sentir combien leur conduite est insensée et déplaît à Dieu ! Sans la philosophie et sans une droite raison, il n’y a pas de sagesse dans l’homme ; tout homme doit donc s’appliquer à la philosophie, la regarder comme la plus noble, la plus importante des études, et placer les autres au second ou au troisième rang. D’ailleurs celles-ci, selon moi, ne sont utiles, estimables qu’autant qu’un peu de philosophie vient s’y mêler ; mais sans philosophie, elles sont fastidieuses, indignes d’un homme libre et bonnes à être reléguées parmi les arts purement mécaniques.
— Ainsi, selon vous, la philosophie fait le bonheur ?
— Oui, lui répondis-je, elle et elle seule.
— Eh bien ! dites-moi ce que c’est que la philosophie et quel est le bonheur qu’elle procure, si toutefois rien ne vous empêche de nous le dire ?
— La philosophie, répondis-je, c’est la science de ce qui est, c’est la connaissance du vrai ; et le bonheur, c’est la possession même de cette science, de cette connaissance si précieuse.
— Mais qu’est-ce que Dieu ? me dit-il.
— Je définis Dieu, l’être qui est toujours le même et toujours de la même manière, la raison et la cause de tout ce qui existe.
Le vieillard m’écoutait avec plaisir ; il me fit ensuite cette question :
— Ce que vous appelez science n’est-ce pas un mot générique qui s’applique à différentes choses ? Ainsi, vous direz d’un homme qui possède un art, qu’il en a la science : par exemple, on dira de lui qu’il a la science du commandement, la science du gouvernement, la science de la médecine. Mais pour les choses qui concernent Dieu et l’homme, existe-t-il une science qui les fasse connaître, qui montre ce qu’elles ont de juste et de divin ?
— Assurément, lui dis-je.
— Quoi donc ! il serait aussi facile de connaître Dieu et l’homme que la musique, l’arithmétique, l’astronomie ou quelque autre science semblable ?
— Oh non ! lui dis-je.
— Vous n’avez donc pas bien répondu à ma question, reprit-il. Certaines connaissances exigent de l’étude et du travail, d’autres ne demandent que des yeux. Si l’on vous disait qu’il existe dans l’Inde un animal qui ne ressemble à aucun autre, qu’il est de telle ou telle manière, de plusieurs formes, de diverses couleurs, avec tout cela vous ne sauriez pas ce qu’il est, si vous ne le voyiez de vos yeux, et vous n’en pourriez raisonner si vous n’en aviez jamais entendu parler à quelqu’un qui l’ait vu ?
— Bien certainement, lui dis-je.
— Comment donc les philosophes peuvent-ils avoir une idée juste de Dieu, ou affirmer quelque chose de vrai sur son être ; car ils ne le connaissent pas, puisque ni leurs yeux, ni leurs oreilles n’ont rien pu leur en apprendre ?
— Mais, lui répondis-je, on ne peut voir Dieu des yeux du corps comme les autres êtres. L’esprit seul peut le concevoir, ainsi que l’enseigne Platon, dont je professe la doctrine.
— Mais, reprit le vieillard, dites-moi ce que vous pensez de l’âme. Saisit-elle plus vite les objets que ne le fait l’œil du corps, ou bien peut-elle voir Dieu sans le secours de l’Esprit saint ?

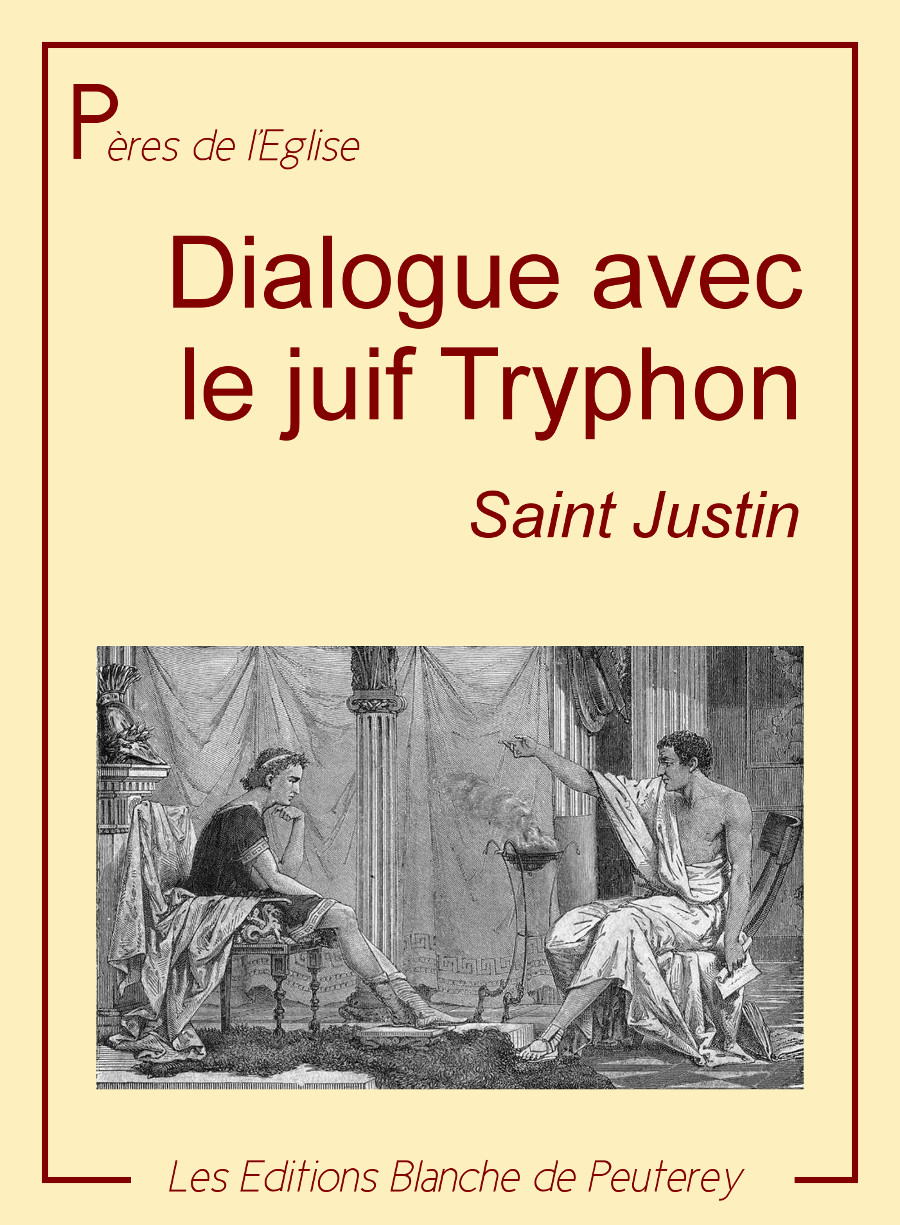
Suivez-nous